Pour apprendre le français en étant débutant ou même pour devenir un écrivain confirmé, il est particulièrement bénéfique de connaître les richesses de notre langue ! Mis en place dès l’école primaire, les cours de français négligent parfois les bagages culturels de la langue. Dans les pays francophones ou dans la métropole, les origines du français sont souvent peu étudiées !
Pourtant, le français est très riche culturellement : pratiquant au départ une langue commune à tous, la France a rapidement développé son propre langage, s’inspirant d’autres nations pour créer une langue particulièrement étoffée. Si vous souhaitez vous présenter à un examen de français (type test de français) ou prendre le français comme spécialité pendant vos études, il faut en passer par l'histoire !
Voici donc toutes nos explications sur l'histoire de la langue française !

Histoire de la langue française : Une langue indo-européenne
L’indo-européen commun date de l’époque bien avant la France, sa capitale Paris et ses régions comme le Nord, de la Préhistoire, et regroupe de nombreuses langues actuelles, ainsi que des dialectes ! Dans ces temps reculés, les langues spécifiques n'existaient pas encore puisque les hommes communiquaient entre eux grâce à un langage commun plus basé sur les gestes physiques.
Cependant, impossible de trouver des traces écrites de l'usage de cette langue ! En effet, l’indo-européen était un langage oral, basé sur la phonétique, la prononciation et la communication entre les peuples. La question des voyelles et consonnes ne se posaient pas encore. Cette particularité a donc compliqué le travail des chercheurs puisque leurs sources étaient plus approximatives : les recherches effectuées restent donc surtout des hypothèses (bien que certaines aient pu être prouvées).

Cet héritage commun est regroupé en 10 branches bien distinctes :
- Les langues italiques
- Les langues indo-iraniennes
- Les langues celtiques
- Les langues germaniques
- Les langues helléniques
- Les langues balto-slaves
- Les langues anatoliennes (elles n'existent plus aujourd'hui)
- Les langues tokhariennes (elle n'existent plus aujourd'hui)
- L’arménien
- L’albanais
Il faudra attendre le XVIIe siècle pour que cette langue ancienne soit découverte par des chercheurs spécialisés en linguistique ! Donc, un siècle après la Renaissance et son roi François Ier. Plusieurs hypothèses ont été émises sur son origine : certains chercheurs affirment que le langage indo-européen viendrait d’une région de la Russie, mais rien n’a pour l’instant été prouvé. Dans les termes utilisés à l’époque, on retrouve des balbutiements du latin et du grec en français !
C’est donc la diversité culturelle de la Préhistoire qui a permis à chaque peuple de développer certaines variations, pour finalement obtenir autant de langages et dialectes différents. L’étude du langage l’indo-européen permet aujourd’hui d’étendre le domaine de la linguistique comparée et de mieux comprendre les différences entre les langages européens ! Cette matière est aujourd'hui surtout étudiée par les universitaires spécialisé en histoire, puisque le langage commun traduisait des habitudes culturelles de l'époque.
Histoire de la langue française : L’héritage latin
Pour apprendre ou enseigner le français, il faut tout d’abord connaitre ses origines ! Le 1er siècle av. JC (donc bien avant la France, sa capitale Paris et ses régions comme le Nord) fut marqué par l’invasion de Jules César et des troupes romaines en Gaule. Le latin devint la langue officielle de l’Eglise, de l’armée et de l’administration : naturellement, le langage de la Gaule en fut bouleversé et les termes furement modifier et évoluèrent pour s'adapter à cette nouvelle culture. Cependant, contrairement à ce que peuvent penser la plupart des gens, les cours de français vous apprendront que le français ne tire pas son héritage du latin écrit classique.
Jean-Marie Pierret, spécialiste linguistique, explique dans son livre Phonétique historique du français :
« Le latin dont procède le français n’est pas le latin classique, c’est-à-dire le latin littéraire de l’âge d’or (du milieu du 1er s. avant J-C. environ jusqu’à la mort d’Auguste en 14 après J-C.), mais le latin parlé habituellement par le peuple. »
Ce latin parlé est souvent qualifié de « latin vulgaire » par les linguistes !
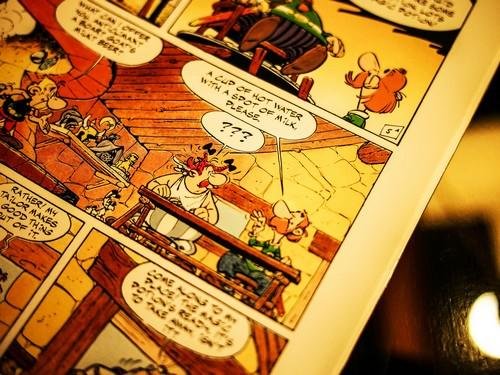
Pour être compris par le peuple, l'usage du latin était donc beaucoup moins littéraire que celui qui peut être aujourd'hui étudié en cours de français. Le langage de l’époque effectuait de nombreux emprunts au latin : noms communs, verbes, adverbes, syntaxe ou encore conjugaison, c’est toute la langue qui a évolué ! Ces emprunts sont facilement discernables à notre époque, en cours de français, puisque la quasi-totalité des mots de notre lexique viennent du latin et subirent beaucoup de petites modifications.
Cependant, l'usage de certains mots, comme « examen », « agenda » ou encore « famille » n’ont connu aucune modification par rapport à leur état d’origine. L’apprentissage du français via la matière du latin proposée à l’école est donc très bénéfique, surtout dans les études littéraires. Selon un sondage de 1001-votes réalisé en 2016, plus de 49% des Français pensent que l’étude du latin est utile ! Apprendre le latin participe donc à promouvoir notre langue, mais également à enrichir notre connaissance dans la linguistique de notre langue officielle.

Histoire de la langue française : premières traces du français ou ancien français ?
Il faut remonter jusqu’au IXe siècle pour voir apparaître les premières traces de l'ancien français ! En ces temps anciens, l'ancien français était un mélange d’emprunts culturels qui venaient de plusieurs pays. En effet, les Français avaient tendance à beaucoup voyager grâce aux nouveaux moyens de transport ! Pour rappel, il s'agit de l'époque, non pas du roi, mais de l'empereur Charlemagne, et du peuple carolingien, siècle où la France prendra géographiquement forme, ainsi que la ville de Paris, ou encore le Nord.
Parmi les langues dont s’inspirait le français, on retrouve :
- La langue arabe
- Le latin médiéval
- Le latin vulgaire
- L’anglais
- Le vieux norrois (une langue scandinave)
Grâce au développement du commerce, l'ancien français put s’exporter au-delà de nos frontières tout en présentant une évolution notable via ses inspirations diverses. C’est particulièrement en Angleterre que l'ancien français s’imposa suite aux conquêtes fructueuses du roi anglais Guillaume le Conquérant !

Cet ancien français est devenu un « français moyen » au XIVe siècle pour enfin arriver au « français classique » à l’époque de la Renaissance, soit au temps du roi François Ier. A travers le rayonnement de l’enseignement supérieur, le français se mit pour la première fois à emprunter des termes au grec. Contexte culturel oblige, le français puisa son inspiration dans les mots italiens puisque cette nation était en pleine expansion ! On commença alors à voir apparaître des termes plus familiers (« horaire », « patriotique » etc.) ainsi que des structures plus complexes (« aigre-doux » etc.). Retrouvez tout ceci via un enseignement à domicile avec des cours de français Superprof !
L’espagnol eut aussi son rôle à jouer, notamment avec la découverte de produits exotiques (« chocolat », « tabac », « patate » etc.). La France commença donc à se modifier en développant un vrai vocabulaire, ce qui pouvait se ressentir dans la littérature de notre pays. L’invention de l’imprimerie permit d'ailleurs au français de se faire une vraie place dans le monde !
Histoire de la langue française : Fondation de l’Académie Française
Amélioré et exporté dans les pays étrangers, le français commença, au XVIIe siècle, à devenir un langage majeur. Face à ce rayonnement, le cardinal de Richelieu décida de créer l’Académie Française en 1634 pour mieux codifier la langue de l’Hexagone ! Le but principal était de modifier et faire évoluer la langue pour la rendre plus riche tout en imposant des normes à respecter pour que l’expansion du français soit mieux régulée.
L’Académie Française comptait (et compte toujours) 40 sièges officiels occupés par des personnalités marquantes de l’histoire. L’expression du « 41ème fauteuil » désigne également des personnalités qui n’ont pas pu accéder à l’Académie, soit à cause d’une candidature rejetée ou bien d’une mort prématurée.
Parmi ces personnages illustres, on retrouve :
- Molière
- Émile Zola (qui fait partie de nos 10 personnalités ambassadrices du français dans le monde)
- Jean-Jacques Rousseau
- René Descartes
- Guy de Maupassant
- Marcel Proust
- Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
- Denis Diderot
Avec diplomatie, les « immortels » de l’Académie participent à la reconnaissance de la langue française en proposant une réflexion et une approche nouvelle de notre grammaire et de notre orthographe. En 1694, le premier Dictionnaire de l’Académie Française fait son apparition et en est aujourd’hui à sa neuvième édition ! Il ouvra ainsi la voie à d'autres dictionnaires aujourd'hui très réputés (comme le Larousse ou le Petit Robert), qui restent tout de même moins officiels que celui de l'Académie.
Pour mieux s’exprimer en français, améliorer notre écriture, et même ne serait-ce que comprendre correctement les voyelles et les consonnes, il faut donc se référer au dictionnaire de l’Académie qui organise et impose les règles de notre langue maternelle. L'Académie Française a par ailleurs décidé de plusieurs réformes orthographiques de la langue française.
Histoire de la langue française : De l’apparition du français moderne à nos jours
L'usage du « français moderne » date du XVIIIe siècle et rayonne encore aujourd’hui ! Après la Révolution Française, les intellectuels se rendirent compte que seulement un quart de notre population parlait le français officiel ! En effet, la sociolinguistique était l’un des causes majeures de ce phénomène : les Français parlaient majoritairement dans leurs langues régionales. Les dialectes étaient ainsi très pratiqués, puisque quasiment chaque région avait sa langue à elle.

Il fallait donc ouvrir la perspective de l'usage d’une langue nationale officielle pour renforcer le sentiment d’appartenance à notre civilisation ! Grâce aux réformes de l’Académie Française, la langue eut la possibilité de se modifier et de mieux s’adapter aux changements sociaux à travers les années. Ce qui a aussi permis au français de rayonner à l'international !
On voit apparaître de nouvelles évolutions :
- Simplification de la terminologie (en conjugaison, le « oi » devient « ai » à « j’avois » devient « j’avais »)
- Nouvelle orthographe française
- Apparition de mots anglais (« bifteck », « club », « punch », « meeting » etc.)
- Nouveaux lexiques pour désigner des concepts modernes (« tramway », « rails », « tunnels » etc.)
- Prise en compte des conséquences de la mondialisation (« show-biz », « cash-flow », « data » etc.)
Cependant, les changements apportés à la francophonie ne plaisent pas à tout le monde ! Selon un sondage réalisé par l’Obs en 2016, 82% des Français se disaient opposés à la nouvelle réforme de l’orthographe ! Malgré tout, si vous souhaitez devenir professeur de français, il y quelques règles à respecter. Avec un passif aussi dense, le français ne passe pas uniquement par la linguistique : les notions historiques méritent d’être connues de tous !
A signaler qu'aujourd'hui, le français est considéré comme la langue de l'amour.
Résumer avec l'IA :















Simple et enrichissant