En chimie, dès que l'on parle de chimie organique, tout devient déjà plus abstrait car nous nous éloignons déjà des bases de la chimie, avec le tableau périodique, les solutions, les réactions acido-basiques… Afin de bien expliquer et de ne pas plonger directement dans trop d'abstrait, il est nécessaire de passer par plusieurs phases et stades et ainsi, d'en arriver aux exemples d'une représentation de formule chimique organique. Pour débuter, moult questions se posent dès lors que l'on parle de chimie organique : pourquoi parle-t-on de "chimie organique" ? D'où vient cette appellation ? Quels sont les éléments entrant en compte dans ce domaine ? En quoi la chimie organique se différence-t-il des autres branches de la chimie ? Que permet-elle de comprendre et d'effectuer en chimie ? Superprof vous donne un (grand) condensé !

Pourquoi parle-t-on de chimie "organique" ?
D'où vient cette appellation, et pourquoi la distingue-t-on des autres secteurs de la chimie ? Il faut savoir que la chimie organique est, très simplement, la science des molécules organiques. Qu'est-ce qu'une molécule organique ? Une molécule organique est une molécule ayant au moins une liaison chimique carbone et hydrogène, c'est-à-dire donc une liaison entre un atome de carbone et un atome d'hydrogène. Si les deux atomes ne sont pas présents dans la liaison, alors il ne s'agit pas d'une molécule organique.
On a bien souvent beaucoup de mal à se représenter les molécules, en débutant la chimie. C'est finalement assez abstrait ! De plus, l'on se demande ce qu'ont les molécules organiques de réellement différent. En réalité, on appelle cela une molécule organique car le vivant est entièrement basé sur la chimie du carbone. Pourquoi parle-t-on à présent du vivant ? Parce que la chimie organique tente par tous les moyens de reproduire ce dont le vivant est constitué - et elle y arrive. Pour ceci donc, il faut s'intéresser grandement à la chimie du carbone, étant donné que le carbone est l'atome du tableau périodique de Mendeleïev qui constitue le vivant. En fait, la grande majorité des molécules constituant tout vivant, de la plante à l'humain, sont produites à partir de carbone. Nous disons bien à partir de, et non pas nécessairement de.
Prenons plusieurs exemples quotidiens : le pétrole, par exemple, est issu du vivant en ce qu'il est formé par le biais de plantes mortes il y a de cela des milliers et des milliers d'années, se transformant au fur et à mesure en pétrole, ce par la pression ainsi que par la chaleur ambiante sur la Terre… Le méthane, autre exemple, provient quant à lui en grande majorité du fumier et des rejets gastro-intestinaux du bétail, à plus de 30%. La photosynthèse est le phénomène à l'origine de toute vie qui transforme le dioxyde de carbone, à savoir donc le CO2, en autres molécules. Les solutions sont, en chimie, une notion tout aussi fondamentale.

Le CO2 lui-même n'est pas organique étant donné qu'il n'y a aucun liaison carbone-hydrogène (CH), mais les molécules formées par la photosynthèse à partir du carbone, la photosynthèse étant une réaction chimique, comprennent quant à elles des liaisons CH. La photosynthèse est donc à l'origine de molécules dites organiques, et voilà l'explication !
Le XXe siècle : passer de la fabrication de molécules "naturelles" à la fabrication de molécules non naturelles
Avant le XXe siècle, les laboratoires reproduisaient uniquement des molécules que l'on retrouve sans cesse partout dans la nature. Cependant, à partir du XXe siècle, on a commencé à créer des molécules n'étant pas retrouvées dans la nature, "artificielles" donc en ce sens. De nos jours, la chimie organique est capable de créer un total de 45 millions de composés chimiques, dont une grande majorité ne se trouvent pas du tout dans la nature !

La nécessité de connaître la chimie du carbone : les formules de représentation des molécules
Pour se plonger dans la chimie organique donc, il convient de s'intéresser à la chimie du carbone. Tout atome de carbone dispose de 4 doublets tous liants. Pourquoi cela ? Il faut se souvenir que puisque le carbone est situé dans la quatrième colonne du tableau périodique de Mendeleïev, cet atome est composé obligatoirement de 4 électrons de valence. Pour rappel, les électrons de valence sont les électrons situés dans la couche dite de valence, autrement dit la toute dernière couche électronique partiellement ou totalement chargée, au sein d'un atome. Les électrons de valence sont ceux qui ont une potentielle charge pour effectuer les liaisons, car ils disposent d'une électronégativité : l'électronégativité est en fait la capacité à attirer des électrons.
Puisque le carbone dispose de 4 électrons de valence, il va "souhaiter" respecter la règle de l'octet et ainsi se rapprocher d'autres atomes des molécules environnantes afin de compléter ses électrons et d'en obtenir 4 de plus pour en détenir 8 au total. En chimie, la règle de l'octet concerne les atomes de numéro atomique supérieur à 4. Selon cette règle établie, l'atome n'est stable qu'une fois que sa couche externe, la couche de valence donc, est totalement remplie avec 8 électrons. Le carbone disposant du numéro atomique Z "6", il convient de trouver quatre autres électrons pour qu'il soit stable. Il va donc chercher naturellement à s'entourer de 8 électrons.
Le carbone s'entoure tout naturellement d'atomes d'hydrogènes, chacun de ces atomes d'hydrogènes ne disposant que d'un seul électron de valence (électron tout court d'ailleurs, ici !). Ils complètent ainsi les 8 électrons au total de l'atome de carbone. Passons à présent à la représentation de cette liaison.

La formule chimique développée de la liaison CH en chimie organique
La formule dite développée vise à tout écrire, symboliquement, dans la représentation et dans la formule chimique de la liaison CH. Cette représentation est très peu utilisée voire jamais étant donné sa longueur. Voyons de quoi il s'agit afin que vous sachiez de quoi tout cela retourne !
Chaque atome d'hydrogène ne doit s'entourer que de 2 électrons pour remplir entièrement sa couche de valence. Parfait ! Ainsi, chaque atome est bien entouré comme il faut : chaque atome d'hydrogène est entouré de deux électrons, et l'atome de carbone est entouré de huit électrons. Afin de faciliter les choses tout d'abord, on enlève les deux points et on remplace cela par un doublet d'électrons, symbolisé par un tiret donc. Ainsi, le tiret fait comprendre tout naturellement que deux électrons sont en commun entre les atomes concernés !
Compliquons les choses. Parlons ici d'une molécule contenant 4 atomes de carbone ainsi que, donc, 10 atomes d'hydrogène.
La formule semi-développée
Dans la formule simplifiée, appelée semi-développée, on facilite la compréhension en limitant les signes étant donné que l'on compte sur le fait que les personnes utilisant et lisant ces formules comprennent ce que les différents signes "facilités" signifient sans que l'on ne soit obligé de tout représenter. Dans l'exemple que nous avons utilisé ci-dessus, on va donc tout simplifier en prenant en compte le fait que l'on comprenne implicitement les choses non rédigées dans la formule. Ainsi, on va avoir :
CH3-CH2-CH2-CH3
La représentation est implicite mais très rapide, donc ! Cette formule semi-développée donne exactement les mêmes informations que la formule développée, et pourtant, elle est beaucoup plus simple à rédiger et permet notamment à tout élève suivant des cours de chimie 3ème secondaire belgique d'appréhender plus facilement la composition de toute molécule : on n'a pas à tout représenter en branches ni avec des pointillés !
La formule topologique de la molécule
La représentation de cette molécule peut s'écrire encore plus simplement, en réalité. Les chimistes aiment à représenter la molécule d'éthanol, par exemple, avec trois branches en forme de V et, près de la troisième branche, y inscrire OH. Cette formule est largement simplifiée car on n'y fait pas figurer les atomes de carbone et, généralement, assez peu d'atomes d'hydrogène. On implicite les liaisons entre carbone et carbone par de simples segments, et les liaisons doubles par des doubles segments.
Qu'est-ce qu'un groupe caractéristique en chimie organique ?
Afin de pouvoir nommer une molécule (la nomenclature), nous avons d'abord besoin de connaître les groupes caractéristiques existants en chimie organique. Pourquoi ? Parce que cela va aider à nommer la molécule, comme nous le verrons juste après. En chimie organique, on appelle groupe caractéristique tout groupe d'atomes conférant des propriétés chimiques spécifiques aux molécules qui les contiennent. On peut ainsi regrouper des sortes de familles, rangées en "groupes".
Classer ces atomes permet en effet de pouvoir prévoir au maximum les réactivités chimiques des molécules. Trois grands groupes caractéristiques (et non pas "familles") sont fréquemment rencontrés.
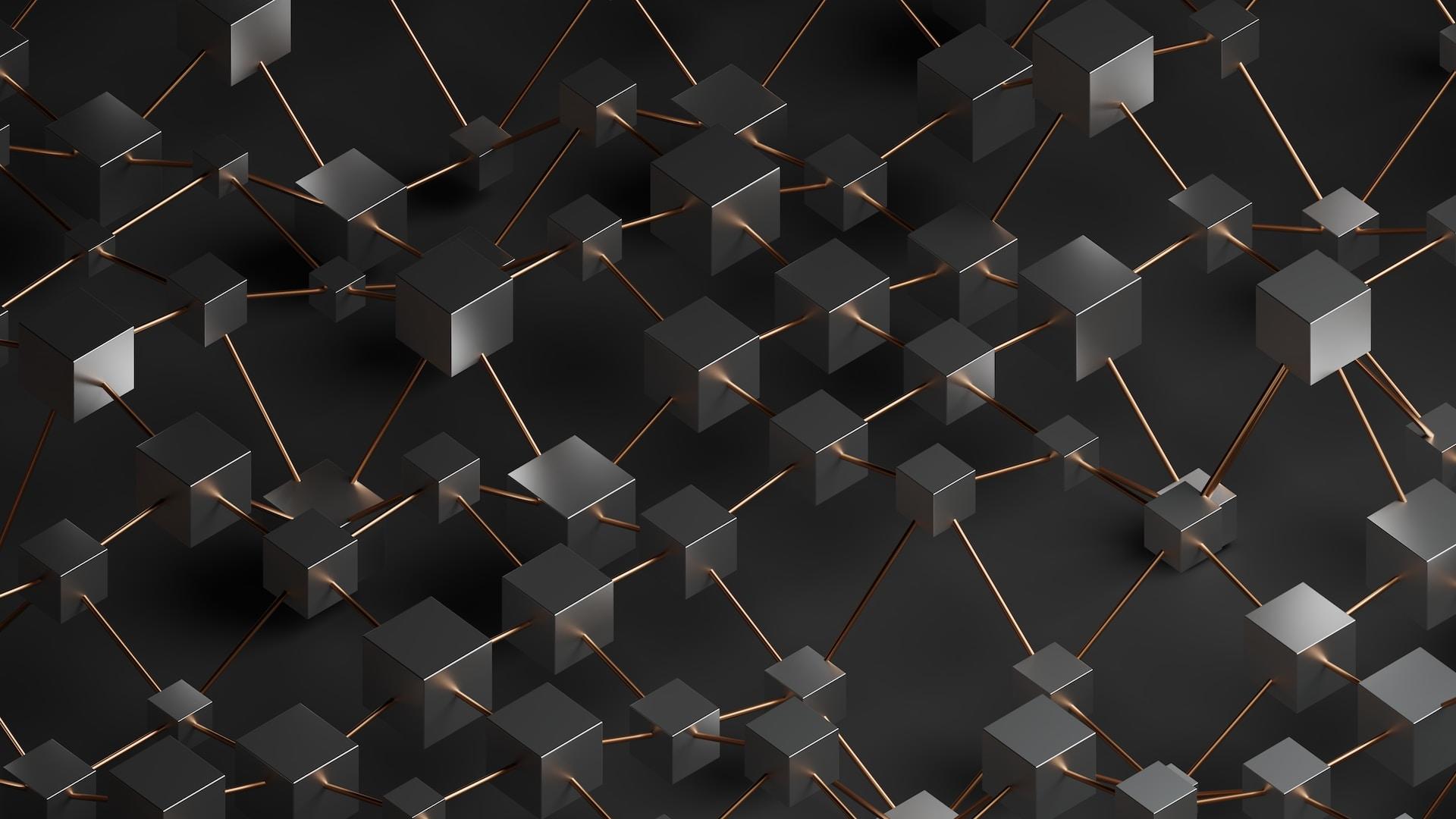
Le groupe hydroxyle : 1 famille
Il s'agit d'un groupement OH car constitué d'un atome d'hydrogène lié à un atome d'oxygène. On appelle ce groupe la famille des alcools, et leur nom termine toujours en -OL.
Le groupe carbonyle : 2 familles
Deux familles se retrouvent ici dans ce groupe. On retrouve dans chacune des deux un atome de carbone et un atome d'oxygène liés ensemble par une double liaison. Si le groupe carbonyle est en bout de chaîne saturée (la chaîne de la formule), alors il s'agit de la famille des aldéhydes. Si le groupe carbonyle est situé au milieu de la chaîne, entre deux atomes de carbone, alors il s'agit de la famille des cétones.
Le groupe carboxyle : 1 famille
Ce groupe se situe nécessairement en bout de chaîne. Un atome de carbone est lié à un oxygène par une double liaison ainsi qu'à un autre oxygène, lui-même lié à un atome d'hydrogène. Il s'agit ici de la famille des acides carboxyliques.
La nomenclature des molécules en chimie organique
Venons-en à présent à la manière de nommer une molécule, quelle qu'elle soit. Il s'agit ici de la nomenclature d'une molécule. Pour nommer une molécule, il convient de connaître les alcanes linéaires. Sur une chaîne "simple", par liaison simple sans liaisons doubles ni triples, on retrouve ce que l'on appelle en chimie organique un alcane linéaire suivi d'autres. Un alcane linéaire est en fait une molécule simplement composée d'atomes de carbone et d'hydrogène. Cette chaîne-ci est appelée une chaîne saturée, sans liaisons autres que simples donc.
Les réactions acido-basiques jouent un certain rôle dans la compréhension de la chimie organique, car un grand nombre des réactions dans le domaine de la chimie organique sont en effet des réactions acide-base. On attribue à chaque chaîne saturée un numéro en fonction du nombre d'atomes de carbone sur la chaîne en question. Voici un petit tableau non exhaustif. Si la chaîne est composée d'un nombre X d'atome(s) de carbone, alors c'est qu'il s'agit nécessairement de la molécule associée :
| Nombre d'atome(s) de carbone contenu(s) dans la chaîne | Nom de la molécule | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | méthane | |||
| 2 | éthane | |||
| 3 | propane | |||
| 4 | butane | |||
| 5 | pentane | |||
| 6 | hexane | |||
| 7 | heptane | |||
| 8 | octane | |||
| 9 | nonane | |||
| 10 | décane | |||
| ... | ... |
La méthode de nomenclature en chimie organique
Trois étapes sont nécessaires ici.
Phase 1 : il convient d'identifier la chaîne carbonée principale, autrement dit, celle qui est la plus longue ET qui contient le groupe caractéristique (et donc la double liaison) !
Phase 2 : numéroter les atomes de carbone de la chaîne, chacun, en faisant en sorte que ce soit celui qui est rattaché au groupe caractéristique qui possède le plus petit numéro.
Phase 3 : nommer la molécule en trois étapes. A savoir : la racine, le suffixe et le (ou les) préfixe(s). Egalement, trois étapes sont nécessaires ici pour la nomenclature :
- Pour la racine, il faut compter le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale. En fonction du nombre, se référer au tableau ci-dessus, en enlevant le -e final du mot associé. Par exemple, pour "méthane", la racine sera "méthan-".
- Le suffixe indique la famille du groupe caractéristique. On peut mettre devant le suffixe, parfois, le numéro de l'atome qui y est rattaché.
- Enfin, le préfixe indique les groupes alkyles rattachés à la chaîne principale, avec le précédant le(s) numéro(s) de/des atome(s) carbone(s) portant ces groupes.
Résumer avec l'IA :















