La chimie fait partie des quelques sciences enseignées au sein de l'enseignement scolaire wallon. Pourquoi ? Tout simplement parce que la chimie est réellement l'une des sciences se trouvant au fondement même de qui nous sommes, de la manière dont nous existons, mais aussi notre entourage et notre environnement. Tout comme la physique, et les maths d'ailleurs, la chimie est l'un des secteurs de sciences les plus fondamentaux pour comprendre ce qui nous entoure. C'est la raison pour laquelle les petits enfants wallons apprennent cette science durant leurs cours de chimie, ou du moins ses bases et fondamentaux, dès leur entrée dans le scolaire, à un âge précoce avec les cours d'éveil aux sciences (physique, chimie) en classes de l'enseignement fondamental.
Et pourtant, malgré l'enseignement scolaire se poursuivant plus tard durant le programme scolaire de chimie en classes du secondaire inférieur (cours de physique-chimie) puis du secondaire supérieur, la chimie n'est pas l'une des disciplines dans laquelle les wallons adultes excellent spécialement. La chimie, de par son immense champ d'application, n'est pas une matière de science très aisée à comprendre. Il s'agit pourtant du réel ! Ainsi, si la chimie devient vite abstraite, il y a toujours une manière d'aborder les notions de chimie pour rendre cela plus clair et ainsi, donner la chance aux débutants en sciences chimiques d'y comprendre quelque chose. Allons-y !

Commencer par comprendre le tableau de Mendeleïev
Commençons par le commencement, n'est-ce pas ? Vous avez bien entendu parler du fameux tableau périodique, inventé par le célèbre chimiste russe Dmitri Mendeleïev, aussi appelé donc tableau de Mendeleïev. Il s'agit du tableau périodique de classification des éléments, les éléments étant des atomes. Tous les atomes répertoriés et rencontrés dans l'Univers jusqu'ici sont classés dans ce fameux tableau, de sorte à les répartir non seulement en groupe (famille), mais également à les classer selon leur nombre de protons et d'électrons. Le tableau de Mendeleïev est encore et toujours très utilisé par les chimistes étant donné son importance et sa richesse d'informations concernant les atomes mais également les protons, les réactions similaires…
Dans ce tableau, on range les atomes du moins chargé en protons (l'hydrogène) au plus chargé en protons (l'oganesson, le plus lourd des atomes, constitué de 118 protons). Pour y voir clair, on range les éléments en familles ainsi qu'en période. Les lignes sont les périodes, et l'on remarque qu'en rangeant les atomes par nombre de protons, on retrouve des caractéristiques très similaires entre atomes de manière périodique.

Déchiffrons à présent ce qui y est inscrit. Car oui, la bonne question serait à présent : cela est bien beau, de savoir ce que ce tableau renferme, mais comment le lire exactement ? Chaque case renfermant un nom d'atome est également constituée d'autres annotations. Le tableau de Mendeleïev se lit de cette façon :
- en haut à gauche se trouve un chiffre/nombre : il s'agit du numéro atomique de l'atome, autrement dit, de son nombre de protons. L'hydrogène, par exemple, est l'atome le plus léger en nombre de protons étant donné qu'il n'en contient qu'un seul. Son numéro atomique est donc tout simplement "1".
- le nom de l'atome est systématiquement inscrit juste en bas de son symbole (atomique) chimique, ici : "H".
- enfin, la masse atomique de l'élément est inscrite en haut à droite. Il s'agit donc de la masse de l'atome, comprenant à la fois les protons et les neutrons.
Dans la masse atomique de l'élément, on compte seulement le poids des protons et des neutrons étant donné que les électrons, du même nombre que les protons, n'ont pas de masse malgré le fait qu'ils aient une charge (négative). Par contre, les neutrons n'ont aucune charge (charge neutre), mais ils disposent d'un poids.
Comprendre les solutions
En chimie, dès que l'on s'éloigne un peu du tableau de Mendeleïev, on se retrouve vite à parler de trois phénomènes fondamentaux en chimie, quelle que soit la branche de la chimie : les solutions, les liaisons chimiques et les réactions acido-basiques. Commençons par les premières citées.
En chimie, les solutions sont nécessairement composées de plusieurs (deux ou plus) éléments. Il y a toujours, en tout cas, un solvant (unique) ainsi qu'un ou plusieurs soluté(s) dans une solution chimique. Le solvant est l'élément central principal, en très grande quantité, qui reçoit le ou les solutés(s). Bien souvent, le solvant utilisé en chimie est l'eau : on dit dans ce cas qu'il s'agit d'une solution aqueuse. Cependant, il peut totalement s'agir d'un autre type de solvant.
Le soluté est à l'inverse l'élément que l'on injecte au sein du solvant. Le soluté est donc en plus petite quantité, et il se disperse nécessairement dans le solvant. Les solutés sont soit de nature ionique (des ions) soit de nature moléculaire (des molécules, donc). Le sel est ainsi un soluté ionique tandis que le sucre est un soluté moléculaire.

Différents types de solutions existent, bien entendu, en chimie. Les plus communes sont les solutions obtenues par dissolution ainsi que les solutions obtenues par dilution. Dans le cas des solutions par dissolution, on verse un soluté dans un solvant pour le dissoudre. Il s'agit toujours ici d'un soluté solide injecté dans un solvant liquide (l'eau, ou par exemple également l'ammoniaque, l'alcool…).
A l'inverse, les solutions chimiques obtenues par dilution consistent à ajouter le solvant à un soluté déjà présent dans un récipient. Il faut ainsi réduire la concentration du soluté présent, sans en changer la quantité. L'exemple typique est l'eau ajoutée à un sirop de cassis !

Comprendre les réactions acido-basiques
Dans le domaine de la chimie, tout ou presque est question de réactions chimiques. Parmi les différents types de réactions chimiques, on retrouve les fameuses réactions acido-basiques. Sans que l'on ne s'en rende nécessairement toujours compte, les réactions acido-basiques forgent notre quotidien. Dans une réaction acido-basique, il y a donc réaction entre un acide et une base. Une base est un élément qui recueille des ions hydrogènes et les transforme. Il peut s'agir de l'eau, mais également de l'ammoniaque encore une fois par exemple. Par contre, un acide est au contraire un élément qui va se débarrasser d'un ou de plusieurs de ses protons pour les donner à une base.
Il faut toujours un couple de deux bases et acides pour que la réaction ait lieu. A chaque fois, l'acide du couple 1 donne son ou ses proton(s) en libérant des ions hydrogènes + à la base du couple 2, tandis que l'acide du couple 2 en fait autant avec la base du couple 1. Il 'agit donc, dans une réaction acido-basique, d'un échange d'ions hydrogènes. Certaines espèces peuvent à la fois jouer le rôle de base et d'acide : le cas le plus typique est celui de l'eau (pure). On dit dans ce cas qu'il s'agit d'une espèce amphotère.
Lorsque la réaction acido-basique a eu pour effet de complètement ou presque dissoudre l'atome d'hydrogène acide, on parle d'acide fort ainsi que de base forte. Si l'ion hydrogène a été peu ionisé, au contraire, alors on parle de base faible ainsi que d'acide faible.
Comprendre les liaisons chimiques
Par "liaison chimique", il faut comprendre toute interaction liant plusieurs atomes entre eux. Ce sont systématiquement des liaisons attractives, attirant d'autres atomes (les électrons des atomes, en réalité) à eux. Cette attractivité des atomes entre eux provient des électrons de valence de chaque atome, situés dans la dernière couche électronique de chaque atome.
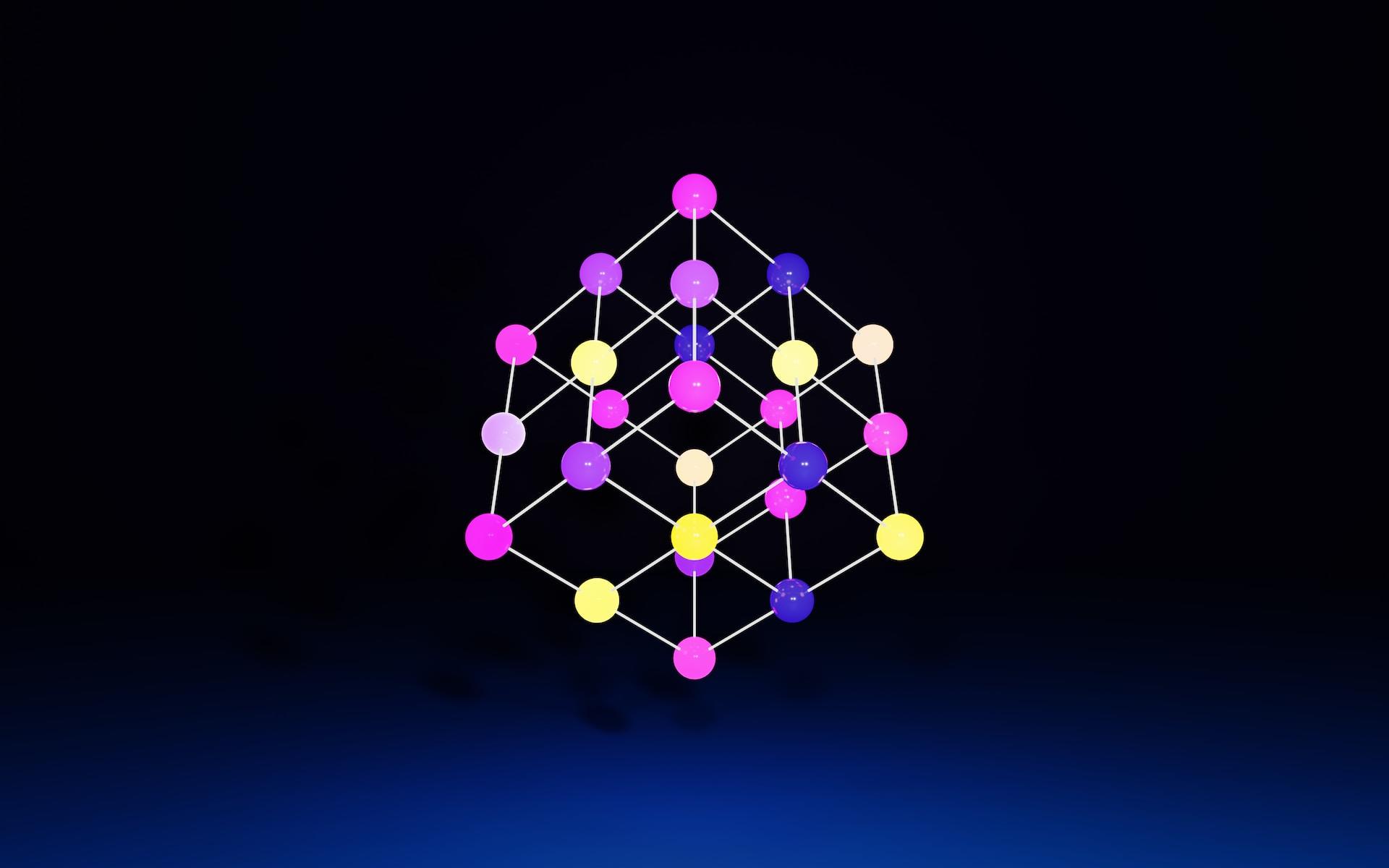
Les électrons de valence interagissent entre eux et, naturellement, les atomes vont se rapprocher des atomes les plus proches de leur configuration propre. Pour être le plus stable possible, un atome nécessite d'avoir rempli entièrement sa couche de valence, autrement dit, celle qui est la plus éloignée du noyau.
Les liaisons chimiques sont nombreuses et variées, se manifestant sous différentes formes. Ainsi, les liaisons covalentes sont les plus courantes, de même que les liaisons ioniques. Les liaisons covalentes correspondent à un véritable partage d'électrons entre atomes. Ceci a lieu uniquement entre deux non-métaux.
Les liaisons ioniques, en chimie, correspondent quant à elles à un échange d'électrons mais pas à un partage. En fait, c'est toujours un non-métal qui va capter l'électron d'un métal, ce dernier ayant une charge électronégative moindre. On assiste donc à l'envie d'un atome de se débarrasser de son unique électron sur sa couche de valence, afin d'avoir la dernière couche vide et celle d'avant, pleine.
Les liaisons métalliques (entre métaux), hydrogènes (entre molécules, dont une est nécessairement une molécule d'eau) et de Van der Waals (liaisons à très basses températures entre deux atomes / molécules ou entre une molécule et un cristal) sont plus rares et plus faibles.
Comprendre la chimie organique
La chimie organique s'intéresse à la chimie du carbone, étant donné que le carbone constitue en grande partie le vivant. En chimie organique, on s'intéresse aux molécules de carbone et d'hydrogène. Car en réalité, on dit qu'une molécule est organique lorsqu'elle a au moins une liaison entre un atome carbone et un atome hydrogène : une liaison CH donc. En chimie organique, on se focalise sur la manière dont on peut recréer une molécule qui existe déjà dans la nature, mais également une molécule n'existant pas dans la nature (depuis le XXe siècle). Il faut rappeler que tous les êtres vivants ont un squelette de carbone !
La chimie du carbone est donc à la base de la chimie organique. Une fois que l'on maîtrise assez la première citée, on peut s'intéresser à la manière dont sont constituées les molécules organiques. La liaison CH fait partie d'une chaîne rattachée à un ou plusieurs groupe(s) caractéristique(s). Les formules diffèrent mais, pour faciliter la représentation d'une formule de chaîne avec au moins une liaison CH, on utilise la formule topologique.
La chimie organique nécessite également des connaissances en nomenclature : pour nommer une molécule contenant une liaison CH, il faut comprendre les questions de racine, de suffixe et de préfixe. Une fois que vous saurez tout cela, vous verrez que vous aussi serez capable de nommer une molécule par sa formule complète ! N'est-ce pas beau ?
Résumer avec l'IA :



















